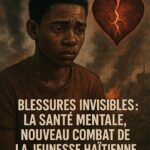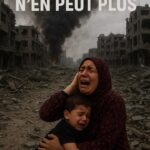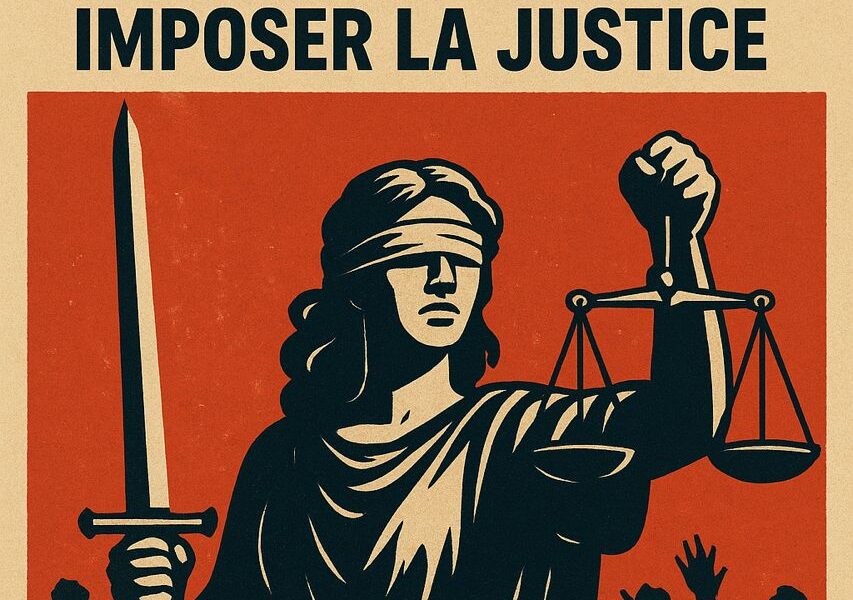
Quand la peur devient loi : refuser la barbarie, imposer la justice.
Par Wilcox TOYO, Psychologue/Journaliste | Octobre 2025 | Port-au-Prince, Haïti. —
Peut-on vraiment répondre à la terreur par la terreur ?
Rien qu’en posant cette question, on ressent l’angoisse d’un peuple à bout. Face aux gangs armés qui mettent Haïti à genoux, la colère est légitime. Mais la JUSTICE ne se construit pas sur des cadavres. Les gangs ne sont pas une fatalité : ils prospèrent dans le vide de l’État. Si les dirigeants refusent d’agir, alors le peuple et la communauté internationale doivent imposer la rupture par la loi, la transparence et la sanction politique.
Assez de discours creux, assez d’hésitations.
Les violences quotidiennes, les enlèvements, les pillages et les extorsions ne sont pas de simples « incidents ». Ce sont des crimes organisés, soutenus par des complicités politiques et économiques que l’on a trop longtemps refusé de nommer. On nous répète qu’« on travaille », qu’« on va enquêter », pendant que nos quartiers saignent et que nos familles sont enterrées vivantes.
Ce déni est une trahison.
Le règne de la peur.
La montée des gangs a transformé nos rues et ruelles en champs de guerre et de peur, et nos vies en interminables comptes à rebours. Les écoles se vident, les marchés ferment, les mères veillent jusqu’à l’aube. Dans ce chaos, une tentation dangereuse émerge : celle de répondre au crime par une violence encore plus grande.
À ceux qui se demandent : « Peut-on tuer pour rétablir la paix ? » Notre réponse est NON, non pas par faiblesse, mais parce que la dignité et l’avenir d’Haïti l’exigent.
La vengeance n’est pas la justice.
La vengeance ne ferait que masquer l’échec d’un État et la médiocrité de ses politiques publiques. Lorsque l’ordre légal est abandonné, c’est la loi du plus fort qui s’impose. Les exécutions sommaires ou les « solutions définitives » ne ramèneront pas la paix ; elles ne feront que prolonger le cycle infernal où victimes et bourreaux se confondent. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une justice à la fois punitive et sociale, fondée sur des procédures claires, la responsabilité et les preuves pas sur des jugements hâtifs.
Dire non à la barbarie, c’est dire oui à la justice.
Refuser la barbarie ne signifie pas défendre l’impunité. C’est exiger des institutions fortes : des forces de sécurité formées et protégées; un système judiciaire indépendant; des enquêtes sérieuses et des procès équitables ; des peines proportionnées, et surtout, le démantèlement des réseaux financiers et politiques qui nourrissent les gangs. Tant que ces réseaux resteront intacts, chaque bande éliminée donnera naissance à dix nouvelles.
Nommer les responsables.
Il faut désormais désigner les coupables de l’effondrement de l’État : gouvernants incompétents ou corrompus, forces de sécurité infiltrées, juges intimidés, élus complices ou indifférents.
L’inaction de l’État n’est pas une maladresse : c’est une porte ouverte aux seigneurs du crime.
La neutralité n’existe plus : soit on protège la population, soit on devient complice.
Nous exigeons que chaque fonctionnaire, officier ou élu rende compte publiquement de ses actes et de ses responsabilités.
S’attaquer aux causes profondes.
Les gangs ne sont que la conséquence visible d’un mal plus profond : la pauvreté, les inégalités sociales, l’abandon scolaire, le manque d’avenir pour les jeunes et la corruption qui siphonne les maigres ressources publiques.
Investir massivement dans l’éducation, la formation professionnelle, la santé mentale et la réinsertion n’est pas un luxe, mais une condition de survie nationale. Les programmes de démobilisation, de réinsertion et de vigilance communautaire peuvent offrir une voie de sortie durable, à condition d’être sincères et correctement financés.
Le rôle des acteurs sociaux et internationaux.
La société civile, les leaders religieux, les organisations communautaires, les acteurs humanitaires et les médias ont un rôle essentiel : porter la voix des victimes, exiger des comptes, rejeter les solutions faciles et plaider pour des réformes structurelles.
La communauté internationale, elle aussi, doit agir non par des interventions punitives sans vision, mais par un soutien logistique, judiciaire et économique ciblé, au service d’un projet haïtien de reconstruction.
Mémoire, réparation et espoir.
Les familles des victimes des gangs ou de la violence d’État méritent la vérité, la justice et la réparation. Aucune paix durable n’est possible sans mémoire et reconnaissance des souffrances subies. Haïti a besoin d’un pacte social et de gouvernance durable : sécurité pour les citoyens, justice pour les coupables, et espoir pour les jeunes.
Accepter la violence comme méthode, c’est renoncer à cet espoir.
Pour une paix fondée sur la loi et la dignité.
Peuple haïtien, ne laissons pas notre dignité être sacrifiée sur l’autel de la colère. Battons-nous, oui mais avec des lois, des preuves, des institutions et une stratégie claire. La paix durable se construit en rompant les complicités et en reconstruisant un État qui protège.
C’est le moment d’exiger le maximum : pas de demi-mesures, pas de compromis, pas de complaisance.
Nous avons le droit d’être en colère. Mais nous avons surtout le devoir de transformer cette colère en exigence de justice, de responsabilité et de réinsertion. Refusons la facilité sanglante. Construisons la paix avec la loi, la justice et la dignité.